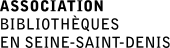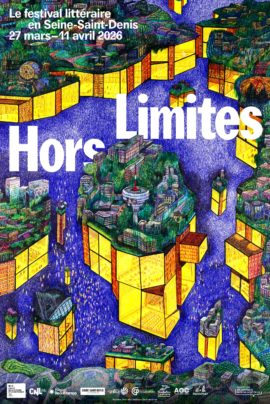« Faire sa rentrée en cinq sorties » avec Lise Wajeman
19 septembre 2025 • 09:30-12:30
Médiathèque Louis Aragon, Rosny-sous-Bois
20 Mail Jean Pierre Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois
Séance #2/2025 : Comité romans contemporains
Le PROGAMME :
Les rendez-vous « Faire sa rentrée en cinq sorties » sont des espaces de réflexion et d’échange autour de la littérature contemporaine, étroitement articulés aux rentrées littéraires de septembre et janvier. Ils visent à accompagner les bibliothécaires dans l’exploration d’une production éditoriale abondante, à nourrir les pratiques de médiation en direction des publics, et à contribuer à la préparation des programmations littéraires, notamment dans le cadre du festival Hors limites. Chaque séance est animée par un·e professionnel·le du livre — critique, journaliste, programmateur·ice — qui propose une sélection de cinq titres récemment publiés. Avec une subjectivité revendiquée, ces choix offrent l’occasion d’emprunter des chemins de traverse dans le paysage éditorial.
Pour cette édition d’automne, nous aurons le plaisir d’accueillir Lise Wajeman, critique littéraire, universitaire et récente pensionnaire de la Villa Médicis. Elle viendra partager avec nous cinq romans de la rentrée littéraire 2025 qui ont particulièrement retenu son attention, et proposera une lecture critique de ces textes, ouvrant la voie à des échanges collectifs toujours riches, passionnés et conviviaux. Ce moment sera l’occasion, comme à chaque rendez-vous, d’affiner notre regard sur la production contemporaine, de questionner les tendances éditoriales, et de faire circuler les impressions de lecture de chacun·es en toute convivialité !
L’intervenante :

Lise Wajeman © SZ
Lise Wajeman est professeure de littérature comparée à l’Université Paris Cité, membre du laboratoire CERILAC, critique littéraire et essayiste. Contributrice régulière de Mediapart, elle s’intéresse aux rapports entre littérature et politique, aux formes contemporaines de l’engagement, à la lecture critique ainsi qu’aux liens entre texte, affect et pensée.
La liste des titres à lire :
Ayoh Kré Duchâtelet, La grotte aux poissons aveugles
Rot-Bo-Krik, à paraître 3 oct. 2025
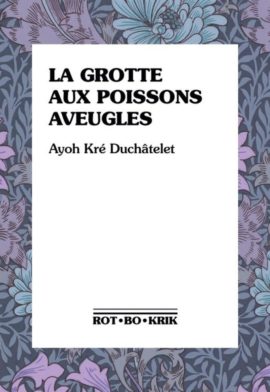
Congo, 2065, plus de trois siècles après la condamnation à mort de la prophétesse Kimpa Vita. L’église d’Épine brûlée, mouvement inspiré par son martyre, est suspectée de collaborer avec les groupes armés du Front de Libération Indépendantiste. Soumise à un interrogatoire, la plus haute autorité de l’église avale l’Eau noire qui l’immerge dans un abysse de visions entre pures fabulations, débris oniriques et, peut-être, faits avérés. Dans ce premier roman, Ayoh Kré Duchâtelet explore les liens entre politique, imaginaire et temporalités. Empruntant à la science-fiction comme à l’horreur, « La Grotte aux poissons aveugles » renégocie les archétypes littéraires de la bibliothèque coloniale.
Présentation du livre chez le diffuseur
La maison d’édition
Percival Everett, James, L’Olivier, août 2025
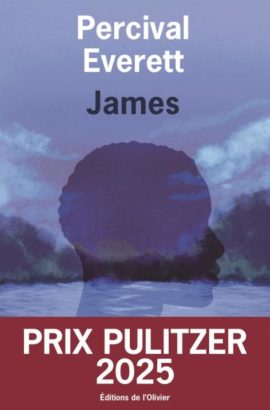
« Ces gamins blancs, Huck et Tom, m’observaient. Ils imaginaient toujours des jeux dans lesquels j’étais soit le méchant soit une proie, mais à coup sûr leur jouet. […] On gagne toujours à donner aux Blancs ce qu’ils veulent. ». Qui est James ? Le jeune esclave illettré qui a fui la plantation ? Ou cet homme cultivé et plein d’humour qui se joue des Blancs ? Percival Everett transforme le personnage de Jim créé par Mark Twain, dans son roman Huckleberry Finn , en un héros inoubliable.
James prétend souvent ne rien savoir, ne rien comprendre ; en réalité, il maîtrise la langue et la pensée comme personne. Ce grand roman d’aventures, porté par les flots tourmentés du Mississippi, pose un regard incisif entièrement neuf sur la question du racisme. Mais James est surtout l’histoire déchirante d’un homme qui tente de choisir son destin.
Joanna Russ, Comment torpiller l’écriture des femmes
La Découverte, août 2025
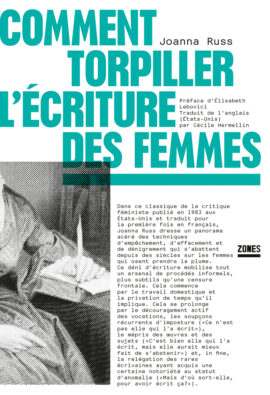
Dans ce classique de la critique féministe publié en 1983 aux États-Unis et traduit pour la première fois en français, Joanna Russ dresse un panorama acéré des techniques d’empêchement, d’effacement et de dénigrement qui s’abattent depuis des siècles sur les femmes qui osent prendre la plume.
En décortiquant les stratagèmes du sexisme ordinaire dans le monde des lettres, Russ signe un formidable anti-manuel de silenciation des femmes autrices, qui n’a perdu ni de son actualité ni de sa force critique. Tout en attaquant la tradition misogyne, elle trace aussi en pointillé une autre traversée de la littérature anglo-saxonne, sur les pas de Jane Austen, Mary Shelley, Emily Brontë, George Eliot, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Adrienne Rich ou Ursula Le Guin.
Nassera Tamer, Allô la place, Verdier, août 2025
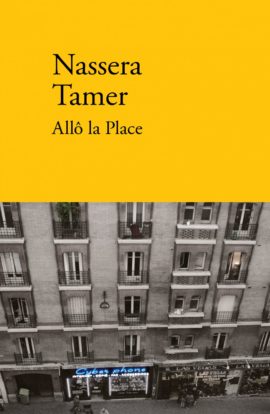
« Longtemps l’arabe s’allie pour moi à l’amer. Je l’ai rejeté de tout mon corps et il me revient par vagues. Je ne l’ai jamais vraiment perdu et j’ai du mal à penser qu’on puisse perdre une langue. Je vis dans la langue de mes parents comme elle vit en moi. ».
Cette « langue-chimère » avec laquelle la narratrice essaie de renouer, c’est le darija, l’arabe marocain. Séparée de ses parents, par une mer et un empêchement existentiel, elle trouve des subterfuges : elle traîne dans les taxiphones parisiens pour l’entendre, y prête attention dans la rue ou les transports en commun, prend des cours à l’Institut du monde arabe, et surtout, forme un tandem linguistique, par écrans interposés, avec Mer, qui vit au Maroc. De Paris au Havre, de Casablanca à Toronto, des fils affectifs et culturels se tissent, se défont puis se refont. Les taxiphones bruissent de ces histoires qu’on se raconte à distance.
Hélène Zimmer, Les dernières écritures, P.O.L, août 2025
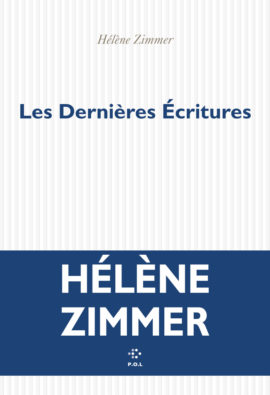
La révélation touche Cassandre Mercier, professeure de français au collège, en ouvrant Le Bilan, un livre-somme sur le dérèglement climatique, inventaire des dernières ressources terrestres. Et en cela, peut-être, la « dernière œuvre ». C’est aussi, dans le roman, le catalyseur de multiples désarrois sociaux et intimes. Croyant tenir entre ses mains les « dernières écritures », Cassandre se lance dans une lecture obsessionnelle du livre-monstre qu’elle impose à ses élèves.
Hélène Zimmer s’inspire des pressions conservatrices actuelles sur l’enseignement, des débats sur la liberté pédagogique et du rôle des adultes face à la crise écologique, lesquels entrent alors en résonance avec la part meurtrie de ses personnages. La conscience de l’inéluctable peut-elle ouvrir sur une promesse de réparation ? C’est aussi une évocation puissante et originale de la fonction des écritures dans l’histoire humaine. À quoi pourraient ressembler « les dernières écritures » ? Les mots sont-ils un rempart au sentiment de « fin du monde » ?